
| ← | ↑ | → |

Il y a cent ans que le roi Louis XVI entrait au Temple,1 et que sa fille, Madame Royale, en traçant la première ligne de ce Mémoire,2 ouvrait la comptabilité lamentable où allaient s'inscrire, à leur date, l'ouvrage et la torture de chaque jour.
Les lignes houleuses de son manuscrit sont frissonnantes encore, on le dirait, du tremblement de sa petite main et de battements précipités de son cœur. C'est qu'à la façon de cet étrange instrument qui emmagasine les sons, cet écrit a emmagasiné des douleurs infinies. Quand elles s'en échappent gémissantes, enfantines encore, malgré le siècle dont elles sont vieillies, peut-il être une âme qui ne tressaille à les entendre ?
Leurs voix, hélas ! n'égarent pas à travers des jeux d'imagination. Ce qu'elles redisent est une histoire vraie, où des crachats et une couronne d'épines ont laissé leurs empreintes, comme sur le voile de Véronique.
Cette passion, elle aussi, a droit à son centenaire ! Quand, sur le seuil de 1893, la France ne retourne pour saluer les grands ancêtres n'est-il pas juste que, par-dessus leurs têtes, elle voie planer ceux qu'ils ont crucifiés ?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rien de plus ne serait à dire, comme introduction au Mémoire de Madame Royale, s'il n'importait de faire connaître comment il est parvenu jusqu'à nous, et si quelques lettres inédites de la princesse ne devaient compléter, par le récit de sa sortie du Temple, celui de son affreuse captivité.
Depuis que Madame Élisabeth était montée à l'échafaud,3 le silence régnait autour du Temple. Ni Paris, ni la France, ni l'Europe, ne semblaient plus se soucier de savoir si, derrière les murailles de la prison, le Dauphin et sa sœur vivaient encore. Hélas ! la durée qui si fort aggrave le mal pour celui qui souffre, le diminue, au contraire, pour celui qui en est seulement le témoin.
Pour rappeler les Enfants de France à ceux qui les avaient faits orphelins, il fallut qu'une brochure fût publiée sous ce titre étrange :
« Un mot pour deux individus auxquels personne ne pense et auxquels il faut penser une fois. »
D'autres écrits suivirent, anonymes aussi. Un murmure de compassion bourdonna autour des prisonniers et bientôt grandit jusqu'à imposer quelque pitié au Comité de sûreté générale...
Le 15 juin 1795, Madame Royale, qui, depuis le départ de sa tante, avait touché à cet excès de souffrances où l'on n'attend plus ni remède, ni soulagement, ni consolation, entendit s'ouvrir la porte de sa prison.
La princesse lisait et ne détourna pas la tête. Elle tremblait de rencontrer devant elle le visage de quelque lécheuse d'échafaud.
Mais non, celle qui entrait tombait à ses pieds, et l'enfant vit de vraies larmes dans les yeux qui la regardaient avec amour.
L'inconnue dit son nom : « Madeleine Hilaire La Rochette. Elle était femme du citoyen Bocquet Chanterenne. Elle demeurait à Paris, 24, rue des Rosiers, section des Droits de l'Homme. »
Dès que la citoyenne Chanterenne avait appris que le Comité de sûreté générale décidait « qu'une femme serait placée auprès de la fille de Louis Capet pour lui servir de compagnie », elle s'était offerte et avait obtenu sa nomination, comme récompense des services rendus par son père4 et par son mari aux finances de la République.
Voilà ce que racontait la nouvelle arrivée. Mais il n'était pas à se tromper au dévouement qui avait inspiré sa démarche ; et il se fit aussitôt comme une explosion de reconnaissance dans le cœur de la royale enfant, depuis si longtemps sevrée d'affections. Le temps et la souffrance avaient eu raison, chez elle, des vagues souvenirs d'étiquette. Que lui importait que la tendresse qui s'offrait fût familière ou respectueuse ? Elle s'y abandonna avec ce même adorable laisser-aller que l'on avait tant reproché à sa mère.
Lisez cette lettre, sans date, mais écrite par la princesse peu de jours après l'entrée de Mme de Chanterenne5 au Temple. Mme de Chanterenne n'y est pas encore la chère Renète6 qu'elle sera bientôt, mais quelle amie elle est déjà !...
Madame,
Il est six heures, votre présence est si agréable à tout le monde qu'il faut vous arracher pour jouir du bonheur de vous voir. C'est ce que je veux, mais néanmoins, comme il est assez simple que vous aimiez votre sœur Jussie, je me priverai du plaisir de vous voir, pour que vous ayez celui de rester plus longtemps avec elle. Je vous donne jusqu'à sept heures. Mais vous reviendrez après, parce que je ne vous ai presque pas vue de la matinée. Vous voyez que malgré ma bêtise de ce matin, je suis encore un peu bonne.
Dites à M. Mabile, s'il est avec vous, que ses plumes ne valent rien, du moins, sont mal taillées, ce qui fait que ce que je vous écris est très griffonné.
Je dois cependant vous dire encore que je suis bien aise de vous avoir fait enrager en vous faisant chercher un peu votre montre. Je l'avais prise et mise à mon côté devant vous, avant que d'aller à la cuisine. Je n'ai pu faire que très peu d'extraits après mon dîné, ce qui fait que je vous écris, ne sachant quoi faire. Mais j'en ferai dans le jardin.
Soyez cependant persuadée que j'aurais sacrifié toutes mes occupations au bonheur de vous écrire, mais à la condition que vous me rendiez ma lettre pour être brûlée.
Et voici la suscription de la lettre : « Pour être lue tout de suite. A Mme Chanterenne, au jardin du Temple ; par delà le fatal guichet, sur un banc nº 2, sous les arbres.7 »
Hélas ! celle qui se livrait, si heureuse, à ce renouveau d'enfantillage, ne savait pas qu'au-dessus d'elle son petit frère venait de mourir.
Ce fut à Mme de Chanterenne de le lui apprendre ; je ne sache pas, dans le livre de M. de Beauchesne, rien de plus tragique que ce dialogue :
« — Madame n'a plus de parents.
« — Et mon frère ?
« — Plus de frère.
« — Et ma tante ?
« — Plus de tante.8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »
Mais, enfin, la Convention était lasse de sang. Elle-même, d'ailleurs, allait mourir. Chose étrange ! le dernier soupir de l'Assemblée régicide fut une sorte de désaveu de son crime. Ce fut elle, en effet, qui engagea avec l'Autriche les négociations qui rendirent la liberté à la fille de Louis XVI.
On raconte que le 26 octobre 1795, au moment où le président déclarait la Convention dissoute, quelqu'un demanda quelle heure il était, et qu'une voix avait aussitôt répondu : « L'heure de la justice. »
La justice ne pouvait plus sauver qu'une enfant !
II
Comme la France, alors, était en guerre avec l'Autriche, les négociations relatives à la mise en liberté de Madame Royale avaient été ouvertes en Suisse, sous le couvert de M. Bourkhard, chef de la régence de Bâle. Il servait d'intermédiaire entre le baron de Degelmann, ministre d'Autriche, et M. Bacher, secrétaire de l'ambassade française.
Le cabinet de Vienne avait d'abord offert une rançon de deux millions que la République refusa. Elle prétendait échanger la princesse contre les prisonniers français que Dumouriez, naguère, avait livrés à l'Autriche. On sait qu'il s'agissait de Sémonville, de Maret et de Beurnonville. Drouet, le fameux maître de poste de Varennes, figurait comme appoint au marché, fort étonné, sans doute, de se voir mettre en balance avec celle qu'il avait livrée.
Les négociations, qui avaient semblé faciles, traînèrent cependant si bien, que le Directoire ne ratifia que le 28 novembre 1795 les signatures données à Bâle.
La princesse devait être conduite à la frontière suisse pour y être échangée contre les personnages nommés tout à l'heure.
Aussitôt avertie, Madame voulut régler avec Bénézech, le ministre de l'intérieur, les détails de son voyage. Elle l'y trouvait fort disposé. Bénézech, qui, au fond, était royaliste, alla jusqu'à lui laisser entendre que le Directoire donnerait à Madame, pour l'accompagner à Vienne, telle femme qu'elle pourrait désirer. Longtemps la princesse hésita entre Mme de Tourzel, Mme de Soucy, la fille de son ancienne sous-gouvernante Mme de Mackau, et Mme de Sérent qu'elle avait toujours vue auprès de Madame Élisabeth.
Sans doute, ce fut ce souvenir qui, enfin, décida du choix de la princesse.
Toutes réflexions faites, Monsieur, écrivait-elle au ministre, je désire que Mme de Sérent m'accompagne. Je rends justice au mérite et à l'attachement de Mme de Soucy pour moi. Mais, dans la position où je me trouve, seule, ignorant absolument les manières du monde, j'ai besoin de quelqu'un qui puisse me donner de bons conseils, et Mme de Sérent est celle que je crois le plus capable de m'en donner de bons par son âge.
J'ai souvent été a portée de la voir, et j'ai reconnu en elle toutes les qualités que je désirais. Si vous ne pouvez me donner avec moi qu'une seule femme, je demande positivement que ce soit Mme de Sérent. Si vous pouvez m'en donner deux, je demande Mme de Soucy pour lui marquer la reconnaissance que je suis (sic) des soins que sa mère a pris de moi pendant quatorze ans...
Et, plus bas, sur la même feuille :
Je vous recommande M. Hûe,9 c'est le dernier des serviteurs de mon père qui resta avec lui en prison. Mon père même me l'a recommandé en mourant. C'est une dette sacrée que je dois à sa mémoire. Il demeure dans l'île Saint-Louis, quai d'Anjou. Il est impossible qu'on ne le trouve pas. Si vous choisissez un de mes gardiens pour me suivre, je demande que ce soit M. Gomin.10 Il y a plus longtemps qu'il est au Temple ; c'est le premier être qui ait adouci ma captivité. Comme il est sédentaire au Temple, je le connais plus que son camarade. J'espère, Monsieur, que vous m'accorderez ces demandes.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Et dans cette lettre pas un mot pour la pauvre Mme de Chanterenne ! C'est que l'Empereur avait stipulé cette cruelle réserve, qu'aucune des femmes attachées à la princesse, pendant sa captivité au Temple, ne l'accompagnerait à Vienne.
Hélas ! Renète n'était pas pour comprendre cet ostracisme qui lui brisait le cœur !
Ma chère bonne petite Renète, ne vous affligez donc pas tant, lui écrivait Madame la veille de son départ. Vous augmentez mon chagrin par le vôtre. Pouvez-vous croire que je changerai pour vous ? Non jamais. Je me souviendrai toujours avec plaisir de ma petite Renète. J'espère pouvoir vous revoir. Rien n'est impossible. Quant à ce moment-ci, je vous prie de rester tranquille, et surtout de vous moins chagriner, et de ne pas tomber malade. Vous êtes philosophe. Eh bien, soyez-le en ce moment.
La journée de demain est bien triste pour vous. Mais, ma Renète, tâchez de vous occuper. Songez au bonheur de revoir votre famille. Il est si doux d'être avec ses parents et amis. Ne songez beaucoup à moi puisque cela vous afflige. J'aurai bien soin des personnes que vous me recommanderez, et je songerai surtout à vous et à votre respectable famille. Je vous remercie, ma Renète, de tout ce que vous avez fait pour moi de bon et d'obligeant pendant les six mois que nous avons été ensemble. Je n'oublierai jamais ce temps-là. Je finis, ma Renète, car je ne sais ce que je dis. Aujourd'hui est un grand jour pour moi, et j'ai la tête troublée.
Adieu, belle, bonne, douce, aimable, gaie, complaisante, franche, charmante Renète.
Mais tant d'affection ne pouvait qu'aggraver la souffrance de Renète. Son cœur se déchirait lorsqu'elle eut à accompagner, le soir du 18 décembre 1795, sa princesse au jardin.
Madame y allait dire un dernier adieu à des amis inconnus. Toutes les maisons étaient illuminées. Aux fenêtres se pressaient ceux qui, depuis quelques semaines, rivalisaient d'attentions, d'efforts pour consoler la captive.
Elle vint au milieu du jardin, de manière à être vue de tous une dernière fois. Il y a des regards dont on peut dire qu'ils portent des parcelles d'âme. Il en est aussi qui viennent d'infiniment loin et s'en retournent plus loin encore.... Les regards échangés pendant cette soirée étaient de ceux-là.11
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Entre temps, le ministre Bénézech, qui avait laissé sa voiture rue Meslay, frappait à la porte de la prison, et remettait au gardien du Temple l'arrêté du Directoire.
La princesse l'attendait au rez-de-chaussée de la tour, dans la salle du conseil. Le Comité de sûreté générale n'avait voulu pour suivre Madame ni de la marquise de Tourzel ni de la comtesse de Sérent. Ah ! quelle envie la pauvre Renète portait à Mme de Soucy, désignée pour accompagner sa chère princesse !...
... La porte enfin s'ouvrit. Madame fit un pas comme pour sortir, puis brusquement elle se rejeta dans les bras de Renète.
Et voilà qu'en l'embrassant, elle lui glissait des papiers froissés plein les mains. Ils recelaient, dans leur plissures, le récit que l'on va lire ; récit sur lequel avait tant pleuré l'enfant, qui aux murailles de sa prison laissait cette prière, comme un dernier souvenir : « O Dieu, pardonnez à ceux qui ont fait mourir mes parents. »
III
Finir sur ce mot serait se conformer à la légende, pour qui la fille de Louis XVI ne saurait être drapée que de sublimités. Eh bien, pour si héroïque que fût son âme, elle avait aussi ses petits côtés charmants de grâce, de tendresse, de simplicité. Pour mettre tant de qualités en relief, peut-il être rien qui vaille ces quelques autres lettres de Madame à Renète, et cette relation qu'elle lui envoyait de son voyage12 :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
... Je donnai (en sortant du Temple) le bras à M. Benezech, écrivait la princesse, et nous nous acheminâmes dans la rue. M. Benezech me parla du rôle que je devais jouer, de regarder M. Méchin13 comme mon père. Il m'exagéra les dangers que je courais ; mais il ne m'intimida pas. Il me parla aussi de choses qui ne me surprirent pas, parce que nous nous y attendions par sa manière d'être.
M. Gomin vous les dira, c'est plus sûr que le papier. Enfin nous arrivâmes assez vite à la rue Meslée, où nous trouvâmes la voiture de M. Benezech. J'y montai avec lui et M Gomin. Nous fûmes plusieurs tours dans les rues. Enfin nous arrivâmes sur les boulevards, en face de l'Opéra. Nous y trouvâmes une voiture de poste avec M. Méchin et Mme de Soucy. J'y montai avec M. Gomin, et nous laissâmes M. Benezech. Aux portes de Paris, on nous demanda notre passeport. A Charenton, la première poste, les postillons ne voulurent pas d'assignats, et demandèrent de l'argent, menaçant, sans cela, de ne pas nous conduire. M. Méchin leur donna de l'argent. Le reste de la nuit se passa très tranquillement. Les postillons nous conduisirent assez vite.
Le lendemain 19 décembre, nous nous arrêtâmes à Guignes pour déjeuner l'espace d'une demi-heure. Ce même jour, à quatre heures, je fus reconnue à Provins, comme on changeait de chevaux, par un officier de dragons. Arrivé à Nogent-sur-Seine, le dragon publia que c'était moi.
La maîtresse de l'auberge où nous étions descendus pour nous rafraîchir me reconnut et me traita avec beaucoup de respect. La cour et la rue se remplirent de monde qui voulait me voir avec bonne intention. Nous remontâmes en voiture, et le peuple me combla de bénédictions et me souhaita mille félicités. Nous allâmes de là coucher à Gray.
La maîtresse de la maison nous dit que le courrier de l'ambassadeur de Venise, M. Cartelli, lui avait dit que je devais y passer avec deux voitures. Nous nous couchâmes à minuit et nous repartîmes à six heures du matin le 20 décembre.
En passant, nous fûmes arrêtés à Troye par le manque de chevaux, M. Cartelli les ayant tous pris. Nous en eûmes enfin. Nous allâmes très doucement dans cette journée, n'ayant fait que 10 lieues par l'amabilité de M. Cartelli. Enfin, le soir [à] Vandœuvres, M. Méchin se résolut de passer M. Cartelli, et montra à la municipalité l'ordre du gouvernement qui portait qu'il prendrait des chevaux préférablement à d'autres. M. Cartelli fit le diable. Mais, enfin, nous l'emportâmes. Nous partîmes à onze heures du soir et M. Cartelli à une heure du matin, le vilain homme ! Notre courrier, qui est un excellent homme, ne l'aime pas, et ne l'appelle jamais que le marchand de toile, parce que sa voiture en est chargée. Ce courrier s'appelle Charra, et il s'est donné bien du mal pour notre route et faire marcher les postillons. C'est un bien bon homme.
Le lendemain matin, nous descendîmes pour déjeuner à Chaumont, où je fus reconnue publiquement par la ville qui courut en foule pour me voir. M. Méchin fit venir la municipalité et lui montra son passeport pour sa femme et pour sa fille.14 On ne le crut pas. Je remontai en voiture et pendant ce court trajet à pied je fus accueillie de mille bénédictions qui partaient du fond des cœurs, et dont je fus bien touchée. Nous allâmes, le soir, coucher à Fay-Billon, faute de chevaux, ce qui nous arrivait souvenir.
La journée du lendemain se passa très tranquillement. Seulement, les chevaux manquaient. Nous ne fîmes dans la journée que 12 lieues. De là, nous couchâmes à Vesoul, et le lendemain nous trouvâmes des chemins affreux, dont on ne peut pas se faire d'idée, des trous énormes, d'où nous ne nous retirâmes que par l'adresse des postillons.
Enfin, après avoir éprouvé mille difficultés et être partis de Paris à minuit, le 18 décembre, nous arrivâmes à Huningue le 24 décembre, à six heures du soir, après six jours de marche.
Ici, la princesse donne la nomenclature de tous les endroits qu'elle a traversés et mentionne le temps qu'elle y a séjourné. Puis elle ajoute :
Ma chère Renète, je vous envoie cette liste et cette relation, pensant que cela vous fera plaisir. Je l'ai faite exprès pour vous. Il est six heures. La seconde voiture est arrivée à trois heures. J'ai demandé tout de suite de vos nouvelles à Baron et à Meunier.15 Ils m'ont dit votre douleur, et j'ai à vous gronder, ma Renète. Ne vous faites pas de mal, ne tombez pas malade, je vous le demande. Ils m'ont dit qu'ils en avaient peur. Voyez souvent Mme de Mackau, je vous en prie, ainsi que M. Gomin. Ce pauvre homme m'a servi avec un soin extrême. Il s'est donné beaucoup de mal. Il ne mangeait ni ne dormait. Je vous le recommande bien, ma chère amie. Il vous remettra cette lettre, j'ai écrit publiquement à Mmes de Mackau et de Tourzel. Mais vous, j'ai mieux aimé vous écrire comme cela pour ne pas me gêner. C'est bien mal écrit, mais je suis sur une table avec M. Méchin qui écrit aussi.
Mme de Soucy et son fils écrivent aussi. M. Gomin et Hûe parlent auprès de la porte. Telle est la position de ce moment, et Coco, mon cher Coco, est dans le coin du poêle à dormir.
Adieu, ma chère Renète, la bien-aimée d'une malheureuse expatriée. J'ai vu ce matin M. Bacher, le secrétaire de France à Bâle. Je le reverrai demain matin ; et demain au soir, à la fin du jour, au moment où l'on fermera les portes, je partirai pour Bâle, et l'échange se fera tout de suite, et aussitôt je partirai pour Vienne, où je serai peut-être quand vous recevrez ma lettre. On parle beaucoup de mon mariage, on le dit prochain. J'espère que non. Enfin, je ne sais ce que je dis. Je vous promets de penser toujours bien à vous. Je ne peux ni ne veux oublier. Ayez soin de ce pauvre M. Gomin qui est dans la douleur de notre séparation. Adieu, chère Renète, la paix est ce que je désire, par plus d'une raison. Puisse-t-elle arriver et puissé-je vous revoir à Rome, mais non à Vienne. Adieu, bonne, charmante, tendre Renète. Ma belle dame....
Cette lettre, on s'en souvient, était datée d'Huningue. La ville alors ne comptait guère que 1,500 habitants. Elle devait être bientôt célèbre par le siège où 135 Français, sous les ordres du général Barbanègre, tinrent en échec, pendant douze jours, 30,000 Autrichiens. Huningue est située à une petite lieue au nord de Bâle, et à 8 lieues d'Altkirch, sur la rive gauche du Rhin.
Madame était descendue à l'hôtel « du Corbeau ». Son appartement au second étage portait le nº 10. Personne à son arrivée ne doutait de la qualité de celle qui voyageait sous le nom de Sophie. Mais bientôt l'incognito s'évanouit. A Huningue, comme partout en France, la présence de Madame excitait une sorte de curiosité enthousiaste qui l'enchantait.
C'est encore à Renète qu'elle en veut faire la confidence le jour même où elle va franchir la frontière.
Huningue, 25 décembre 1795, au soir.
Ma chère petite Renète, je vous aime toujours bien et je commence, malgré vos conseils, à écrire au haut de la page pour vous dire plus de choses.
... J'ai été reconnue dès le premier jour à Provins. Ah ! ma chère Renète, comme cela m'a fait de mal et de bien ! Vous ne pouvez pas vous faire l'idée comme l'on courait pour me voir.
Les uns m'appelaient leur bonne dame, d'autres leur bonne princesse. Les uns pleuraient de joie, et moi j'en avais aussi bien envie.
Mon pauvre cœur était bien agité et regrettait encore plus fort sa patrie qu'il chérit toujours bien.
Quel changement des départements à Paris ! On ne veut plus d'assignats depuis Charenton. On murmure tout haut contre le gouvernement. On regrette ses anciens maîtres et même moi, malheureuse. Chacun s'afflige de mon départ. Je suis connue partout, malgré les soins de ceux qui m'accompagnent. Partout, je vois augmenter ma douleur de quitter mes malheureux compatriotes, qui font mille vœux au ciel pour ma félicité. Ah ! ma chère Renète, si vous saviez comme je suis attendrie ! Quel dommage qu'un pareil changement n'ait pas eu lieu plus tôt ! je n'aurais pas vu périr toute ma famille et tant de milliers d'innocents.
Mais laissons un sujet qui me fait trop de mal. Mes compagnons de voyage sont très honnêtes. Notre M. Méchin est un bon homme, mais bien peureux, il craint que les émigrés viennent m'enlever ou que les terroristes ne me tuent. Il y a peu de ces gens-là. Mais il craint à cause de sa responsabilité. Il veut faire un peu le maître, mais j'y mets bon ordre. Il m'appelle quelquefois sa fille dans les auberges ou bien Sophie, mais je ne l'ai jamais appelé que monsieur. Il a dû voir que cela me déplaisait. Mais il a pu s'épargner cette peine, car dans toutes les auberges on m'appelle « Madame », ou « ma Princesse ».
On vient de m'apprendre que ma maison est formée et qu'elle m'attend à Bâle pour me conduire à Vienne. Jugez, ma chère Renète.... Cette femme (Mme de Soucy) a emmené avec elle son fils et sa femme de chambre, et l'on m'a refusé une femme pour me servir ! J'ai tâché de démêler l'intrigue qui vous avait empêchée de me suivre. Je crois que cela vient de Mme de M... ; d'un autre côté, on m'a dit que l'Empereur avait demandé qu'il ne vînt avec moi aucune des personnes qui avaient été au Temple, et qu'on n'aura pas fait de différence de vous aux autres, ma Renète.
Cela m'afflige bien, car je vous aime bien et ai besoin de donner ma confiance et d'épancher mon cœur dans le sein d'une personne que j'aime, ce que n'est pas la personne qui me suit, car je ne la connais pas assez pour lui dire tout ce que je sens. Il n'y a que vous, ma bonne Renète, à qui je puisse me livrer ; je suis bien malheureuse, je n'ai qu'une personne que je voudrais avoir et je ne l'ai pas.
Priez Dieu pour moi, je suis dans une position bien désavantageuse et bien embarrassante. On fait courir le bruit que l'on va me marier dans huit jours. Certainement à mon amoureux (?). Mais cela ne sera pas du moins de longtemps. Je verrai aujourd'hui l'ambassadeur de France, et demain je partirai pour Bâle.
Adieu, ma chère bonne Renète... je me ressouviendrai de vos parents allemands.
Dans la journée qui suivit, M. Méchin reçut une lettre de M. Bacher, qui l'informait que le lendemain, entre quatre et cinq heures, il viendrait prendre la princesse pour la conduire auprès du prince de Gavre et du baron de Degelmann, chargés par l'Empereur de la recevoir.
Le lieu de l'échange avait été fixé dans une petite habitation appartenant à M. Reber, négociant à Bâle, et située non loin de cette ville, sur la route d'Huningue.
Toutes les précautions étaient prises pour écarter les regards indiscrets. Les représentants de l'empereur d'Autriche occupaient depuis une demi-heure la maison de M. Reber, lorsque la voiture de la princesse y arriva.
Le 26 décembre 1795, un simple écrit ainsi conçu donnait à la République française quittance de la fille de Louis XVI :
« Je soussigné, en vertu des ordres de Sa Majesté l'Empereur, déclare avoir reçu de M. Bacher, ambassadeur français délégué à cet effet, Mme la princesse Marie-Thérèse-Charlotte, fille de Sa Majesté le roi Louis XVI. »
IV
Le manuscrit et toutes ces lettres de Madame n'étant pas sortis des mains de Renète, on pourrait les croire absolument inédits. Cependant il n'en est pas tout à fait ainsi, du moins en ce qui concerne le récit de la captivité au Temple. Et voici comment il a pu être entrevu par le public.
Un jour, à Mittau, Madame voulut revoir le manuscrit qu'elle avait donné à Renète. C'était en 1805. Pensait-elle à comparer les douleurs de sa prison aux souffrances qu'elle avait affrontées depuis qu'elle était sortie de France ? Peut-être. Quoi qu'il en soit, Madame faisait redemander le manuscrit de Mme de Chanterenne par le fidèle Cléry et en fit elle-même une copie. Elle y ajouta quelques phrases, en supprima quelques autres, et puis enfin, lorsqu'elle revint en France, elle renvoya à Renète l'original auquel Renète attachait tant de prix.
La copie faite à Mittau fut donnée à Mme de Soucy, sans doute en souvenir du voyage pendant lequel elle avait, lors de la sortie du Temple, accompagné Madame jusqu'à Vienne.
Comment et pourquoi Mme de Soucy se permit-elle de faire imprimer ces pages en 1823, c'est ce que je ne saurais dire. Mais elle se le permit, et grand fut le mécontentement de Mme la duchesse d'Angoulême en apprenant l'indiscrétion commise.
Par son ordre, tous les exemplaires que l'on parvint à découvrir furent rachetés et détruits. Il y en eut un, deux, trois, peut-être, qui cependant échappèrent aux recherches. M. Nettement en eut connaissance. M. de Pastoret s'en servit. M. de Beauchesne lui fit de nombreux emprunts. M. le baron de Saint-Amand, enfin, y a puisé pour son livre intitulé : La Jeunesse de Mme la duchesse d'Angoulême.
Mais ces diverses publications ne peuvent qu'aviver l'intérêt de ces souvenirs qui jusqu'ici n'ont point été donnés dans leur texte vrai.
M. de Pastoret surtout en a agi, avec l'écrit de Madame, de si cavalière façon qu'il lui a enlevé ce grand caractère de simplicité dont on peut dire qu'il est l'authentique de la relique.
Relique, dont l'étrange destinée a quelque analogie avec celle de la sainte qui nous l'a léguée. Le flot l'a ballottée jusqu'à ce qu'un dernier remous l'ait apportée à Frohsdorf.
Quelques mois à peine avant la mort de M. le comte de Chambord, le petit-fils de Mme de Chanterenne envoyait le manuscrit au prince comme un suprême hommage.
Mme la duchesse de Madrid recueillit ce trésor dans la succession de son oncle, et c'est à Viareggio que l'auguste princesse permit que l'autographe de Madame Royale fût, pour ainsi dire, décalqué par une main fidèle.16
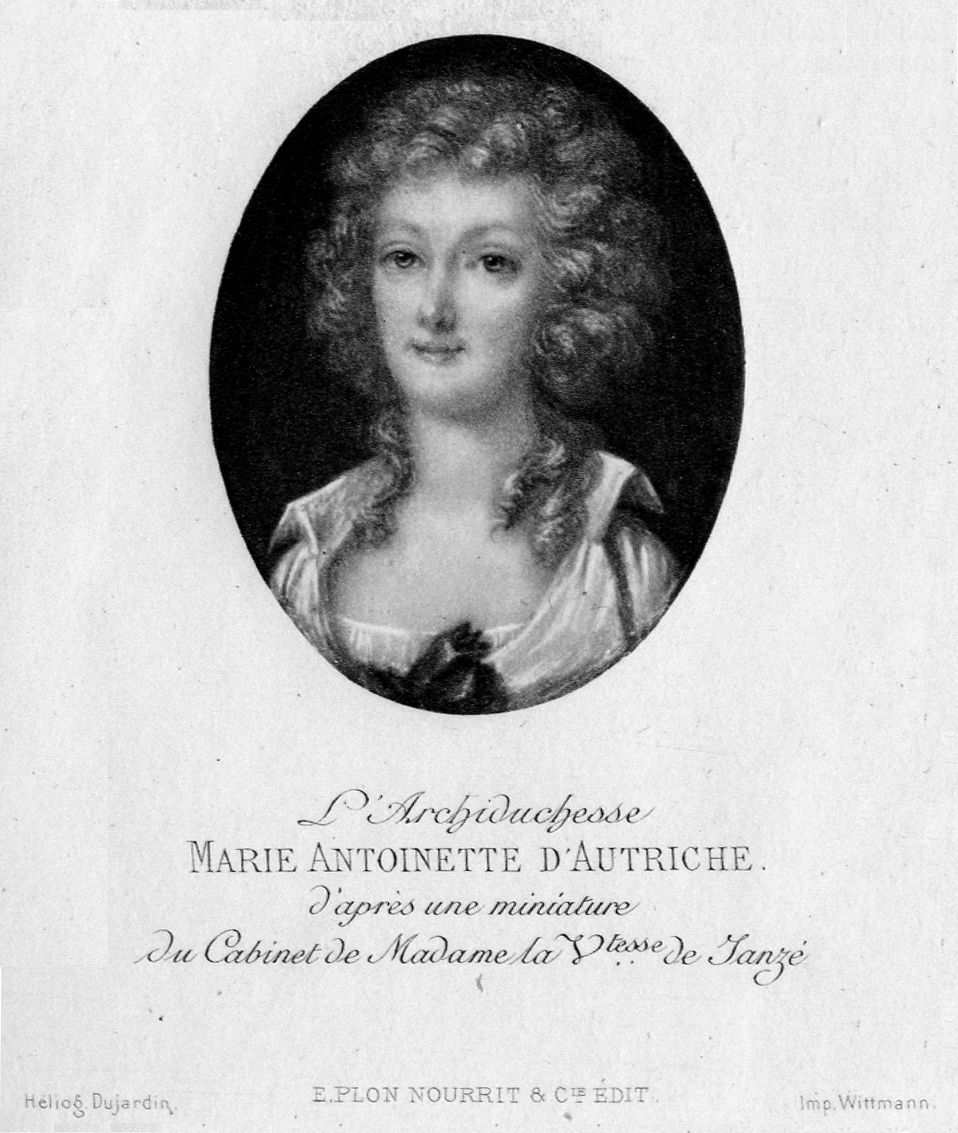
Commencé le jour de l'entrée au Temple, le récit se termine à la mort de M. le Dauphin. La princesse a, en quelque sorte, scellé le cercueil de son frère avec ces mots :
J'atteste que ce mémoire contient vérité,
ou plutôt elle a mis ainsi le signet à la première page de sa vie douloureuse...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Car le livre ne se fermera pas. Les feuillets s'y ajouteront, et toujours tragiques jusqu'à la fin.
Le souffle glacé de la prison a flétri l'avenir pour Madame Royale. Sa beauté passera à peine éclose... Son bonheur n'aura qu'un jour... Ses seuls triomphes seront des triomphes de larmes ; l'admiration qu'elle soulèvera sera faite de pitié. On la verra errer de la prison à l'exil, d'un exil à un autre....
Et, parmi les naufrages de sa vie, elle rappellera jusqu'à la fin cette figure désolée qui se cramponnait à la barque de Dante et répondait, interrogée sur son nom :
« Vedi che son un che piango17... »
V
On a dit que l'humanité avait des réminiscences et que, sans s'en rendre compte, elle se répétait.
Puisse la chose être vraie pour les victimes, autant qu'elle semble devoir l'être, hélas ! pour les bourreaux ! Ceux-ci n'ont rien perdu de leur rage, mais celles-là ne paraissent plus avoir la force de l'affronter.
Fut-il jamais un temps décevant à l'égal du nôtre, et les jours d'abominations révolutionnaires ne valaient-ils pas mieux dans leur horreur qui trempait les caractères, que notre temps énervé qui les dissout ?
Entre la fin du siècle dernier et la fin de ce siècle-ci existe toute la distance qui sépare la plaie saignante de l'anémie honteuse. Il en est parmi nous qui n'ont même plus la force d'être heureux !
Tel qui devrait l'être se débat, à quinze ans, à vingt ans, dans le marasme.
Les enfants eux-mêmes, aujourd'hui, sont des inquiets, des compliqués, des tourmentés ou des blasés.
Montrer à ces névrosés l'image de la réaction rédemptrice, c'est donc faire œuvre utile. La voilà, cette image.
Elle s'encadre dans la simplicité de tous les sentiments. C'est une enfant qui pleure comme une enfant doit pleurer, qui espère de toutes les espérances enfantines, et qui, lorsqu'elle ne pleure pas, sourit parce qu'elle souffre un peu moins.
Pourtant tous les abandons, toutes les amertumes, toutes les déchéances se sont abattus sur elle ! Il faut qu'elle aussi, comme on l'a dit pour sa mère, il faut qu'elle aussi boive lentement et longuement la mort !
Sans feu, sans lumière, réduite à cacher ses pieds nus sous sa robe trop courte, à souffrir de la faim devant son pain noir, l'enfant, tombée des splendeurs de Versailles dans le cachot du Temple, ne se plaint pas, ne maudit personne.
Pour lambris, elle a de hideuses peintures révolutionnaires. Ses nuits se passent sur une couchette de bois rembourrée d'une paillasse grossière. Obscurcies par des toiles d'araignée, les vitres laissent à peine tamiser la lumière dans sa prison.
Engourdis par le froid, ses doigts sont inhabiles à rapiécer « la pauvre robe de soie puce » qui tombe en lambeaux.
Elle a eu, pour attacher ses adorables cheveux blonds, un bout de ruban.... Elle n'en a plus. Il lui faut les enrouler sous un fichu. Ah ! si son visage rappelle le visage du Roi et surtout celui de Madame Élisabeth, c'est qu'il a pris une gravité inouïe pour son âge.
Sa beauté a grandi, oui, mais comme ces fleurs qui ne s'épanouissent que sur les ruines. Jusqu'à l'arrivée de Mme de Chanterenne, l'enfant a vécu seule.
Mais elle s'est attachée à cette solitude. Son âme s'y affranchit un peu du malheur.
C'est la seule liberté qu'ait l'enfant. L'isolement lui apporte même, parfois, une sorte de bienfaisant engourdissement. Son immobilité est un repos pour son corps. Dans l'abandon où elle vit, son âme se ferme et s'endort : elle peut rêver, et son rêve franchit les murailles de son cachot.
Elle est libre : son amour, ses souvenirs, ses espérances, ressuscitent dans cette liberté. Comme son petit frère mourant, elle entend pendant son hallucination, des harmonies où se mêle la voix aimée de sa mère....
Et quand elle se réveille, la prisonnière a trouvé dans son rêve bienfaisant la patience pour accepter de nouvelles souffrances. Toujours elle ignorera les révoltes de la douleur.
Cependant ces visions sont trop humaines, trop terrestres encore pour lui donner cette résignation. D'où venait-elle ainsi toute-puissant dans son cœur ?
On veut aujourd'hui de l'analyse à outrance. On veut ausculter toutes les vaillances, comme toutes les agonies. On prétend arracher au cœur le secret de ses faiblesses, comme celui de sa force à se raidir.
Ah ! si dans cette tour du Temple, où tout a été surhumain, la résignation de la princesse s'est montrée l'égale de ses souffrances, c'est que son âme y a vécu, comme sur ces sommets de Gethsémani où les anges se rencontrèrent pour soutenir les défaillances du Maître.
Chaque matin, à la place même où l'un après l'autre tous les siens l'avaient embrassée pour aller à l'échafaud, l'enfant s'agenouillait, pour donner, selon ce mot admirable de sa tante, « la main dans le ciel à la résignation. »
« Que m'arrivera-t-il aujourd'hui, ô mon Dieu !... disait-elle après Madame Élisabeth, je ne le sais ; mais ce que je sais, c'est que rien ne m'arrivera que vous n'ayez prévu, ordonné de toute éternité.... Et cela me suffit18... »
Vain apparaît cet abandon à ceux qui s'efforcent d'arracher Dieu aux douloureux, sans voir qu'en même temps ils leur arrachent le droit de dire : « Mon Père, je remets mon âme entre vos mains... »
La foi divise l'humanité, comme le Christ en croix sépara jadis les deux larrons. Les uns meurent de leur blasphème, les autres s'apaisent dans la suprême promesse....
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Et, de même qu'à l'heure où le Christ expira, les morts ressuscitèrent pour confesser sa divinité, de même la prisonnière du Temple, un siècle après son martyre, revient pour rendre témoignage, devant la génération présente, que le Christ est vraiment le Dieu des malheureux !
Notes
1. 13 août 1792.
2. Le manuscrit de Mme la Dauphine est rédigé sur un cahier de 35 pages et demie et de 31 centimètres de hauteur sur 22 centimètres de largeur. Le papier en est fort grossier. La couverture du manuscrit, faite d'une feuille du même papier, porte en titre : Mémoires écrit par Marie-Thérèse-Charlotte de France sur la captivité des princes et princesses ses parents, depuis le 10 août 1792 jusqu'à la mort de son frère arrivée le 9 juin 1795.
3. Madame Élisabeth avait quitté le Temple le 9 mai 1794.
4. Hilaire de la Rochette, gentilhomme poitevin, avait mis, lors de la guerre des Indes, plusieurs navires dont il était armateur au service du Roi. Ces navires avaient péri. Les finances royales s'en étaient reconnues comptables vis-à-vis de lui. La République avait fait de même, mais, ne pouvant payer, avait, comme compensation, donné un emploi du finance à M. de la Rochette et à son gendre., malgré leurs opinions royalistes.
5. Mme de Chanterenne avait alors trente ans. Les renseignements fournis sur elle, au Comité de sûreté générale, portaient que « ses mœurs était douces ». Le certificat ajoutait qu'elle parlait bien le français, l'italien, l'allemand, « et qu'à Gouilly, où elle avait habité, on ne doutait pas de son civisme. »
6. Mme de Chanterenne s'appelait Renée ; la princesse, de Renée, avait amicalement fait Renète.
7. Les originaux de toutes les lettres de Madame Royale, que l'on trouvera au cours de ce récit, sont conservés comme des reliques au château de Bazenville, près Bayeux, par le petit-fils de Mme de Chanterenne.
8. Louis XVII, par M. de Beauchesne, p. 365, vol. II.
9. Bénézech, sous prétexte de faire porter à Bâle le trousseau de la princesse, y envoya aussitôt le fidèle serviteur.
10. Gomin était en ouvrier tapissier de l'île Saint-Louis, qui, le 9 novembre 1794, avait été nommé adjoint à la garde du Temple et qui, en cette qualité, avait adouci autant qu'il avait dépendu de lui l'agonie du Dauphin. Dans cette sinistre galerie de monstres pour lesquels le Temple sera un éternel pilori, la douce et compatissante figure de Gomin se détache comme se détachent aux frises des vieilles cathédrales les figures de saints parmi les guirlandes de damnés. Gomin mourut à Pontoise en 1841.
11. Il existe à la Bibliothèque nationale un portrait de Madame Royale, fait à l'aide d'une longue-vue, par un de ces fidèles. Ce portrait est connu sous le nom de portrait au télescope.
12. Ce récit adressé à Mme de Chanterenne renferme de nombreux détails qui ne se trouvent pas dans celui qu'a publié M. de Beauchesne.
13. Méchin était un capitaine de gendarmerie dont on avait fait un grand éloge à Madame. Méchin était chargé de diriger le voyage.
14. Dans le récit de M. de Beauchesne la princesse s'appelle Sophie.
15. La seconde berline sortie à une heure du matin de Paris contenait M. Hüe, le fils de Mme de Soucy, une femme de chambre et Coco, le petit chien de Madame, ainsi que Meunier et Baron. Le premier était cuisinier, le second valet de chambre de confiance.
16. M. Gabriel de Saint-Victor.
17. Tu le vois, je suis celle qui pleure.
18. Prière composée au Temple par Madame Élisabeth.
Mémoire écrit par Marie-Thérèse-Charlotte de France sur la captivité des princes et princesses ses parents. Depuis le 10 août 1792 jusqu'à la mort de son frère arrivée le 9 juin 1795. Publié sur le manuscrit autographe appartenant à Madame la Duchesse de Madrid. Paris : Librairie Plon, n.d [1892]. Introduction, pp. 1-51.
This page is by James Eason.